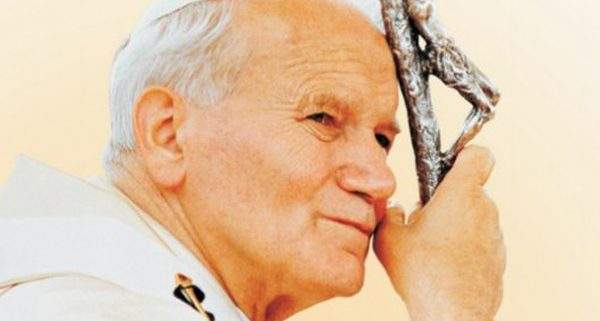Certains s’étonnaient qu’à cette époque Jean-Paul II parlait si fortement de la paix. Il y avait des voix qui le considéraient comme “neutre”, “impartial”, ou même un partisan des Arabes ou du tiers monde. D’autre part, on a tenté de lui attribuer une affiliation pacifiste et de lui attacher une étiquette idéologique, politique. C’était, pour ainsi dire, une insulte à un homme fondamentalement doux, pacifique, qui n’avait jamais eu recours à la violence. C’était une insulte à un Polonais qui avait personnellement vécu le cauchemar de deux régimes totalitaires, et qui plus est – au Pape, témoin de la paix de Dieu, avocat de la paix pour toute l’humanité.
Le 17 janvier au matin, lorsqu’il a apprit ce qui s’était passé, il a célébré la messe pour la paix dans sa chapelle. Il était profondément aigri. Il ne pouvait pas comprendre comment il était possible de ne pas trouver un moyen d’arrêter le conflit.
Lors de l’audience générale, il a déclaré : « J’ai fait tout ce qui était humainement possible. Cependant, il ne se contentait pas de ressasser ce qui n’avait pas été fait. Il a convoqué immédiatement ses collaborateurs de la Secrétairerie d’Etat pour décider de ce qui restait à faire sur le plan humanitaire et diplomatique. Ainsi est née la première grande initiative de convoquer à Rome les représentants de l’épiscopat des pays impliqués directement ou indirectement dans la guerre du Golfe.
Et pourtant le Saint-Père avait raison. Il a jugé à juste titre que ce conflit était par définition inutile. Tout d’abord, il annonçait des conséquences tragiques pour la population civile et prévoyait de nouvelles complications pour tout le Moyen-Orient.
Avec le consentement du cardinal Stanisław Dziwisz – “Témoignage”.
Maison d’édition TBA. Varsovie 2007